L’IFS est bien plus qu’un outil thérapeutique – c’est une rencontre qui a bouleversé mon parcours. J’ai découvert Richard C. Schwartz, thérapeute familial américain et fondateur du modèle Internal Family Systems, grâce à la plateforme Quantum Way. Sa démarche m’a tout de suite interpellée : au lieu de chercher à « corriger » des symptômes, il écoute les multiples parts qui cohabitent en chacun. Richard Schwartz a conçu l’IFS dans les années 1980 alors qu’il constatait que ses patients parlaient spontanément d’une « part de moi qui a envie de… » ou d’une « part de moi qui se sent… ». C’est ce qui l’a conduit à considérer le psychisme comme une « famille intérieure ». Ce regard compatissant et non‑pathologisant, où chaque part a une intention positive même lorsqu’elle produit un comportement extrême, m’a profondément touchée.
En lisant ses ouvrages et en comprenant que nos émotions refoulées finissent par peser sur le corps, j’ai pris la décision d’entamer moi‑même une thérapie IFS. Cette exploration de mon “système familial intérieur” m’a permis de reconnaître mes parts protectrices et exilées, de dialoguer avec elles et d’y apporter de la douceur. C’est une rencontre qui a transformé ma vie intérieure. Et, elle résonne aujourd’hui dans chacun des articles de Chemins de vies, où je partage cette voie de reconstruction.

Le parcours de Richard C. Schwartz
Richard C. Schwartz est un thérapeute familial et auteur américain né en 1949. Il obtient un doctorat en thérapie familiale (Marriage and Family Therapy) à l’Université Purdue, après des études de psychologie à l’Université de Rochester. Spécialisé dans l’approche systémique (qui envisage la famille comme un système d’interactions), il entame sa carrière dans les années 1980 en tant que professeur et thérapeute familial. Richard Schwartz enseigne d’abord à l’Institut de recherche juvénile de l’Université de l’Illinois à Chicago. Puis, il rejoint le Family Institute de l’Université Northwestern.
Dès ses débuts, il remet en question les méthodes thérapeutiques traditionnelles. Car, malgré les outils classiques de thérapie familiale, il constate que certaines souffrances de ses patients persistent. Intrigué, il devient attentif à ce qui se joue à l’intérieur de chacun. Ce questionnement marque le point de départ d’une découverte majeure qui va redéfinir sa pratique.
La naissance de l’IFS : écouter nos « parties » intérieures
Au fil de son travail clinique dans les années 1980, Richard Schwartz remarque un phénomène récurrent : ses patients utilisent spontanément des expressions comme « une part de moi a envie de… » ou « une partie de moi se sent coupable ». Ils décrivent des voix intérieures multiples, avec des émotions et des désirs parfois contradictoires. Comme si différentes « personnes » cohabitaient en eux. Plutôt que d’ignorer ces propos, Richard Schwartz y voit une piste précieuse.
Fervent de thérapie familiale, il transpose ses outils systémiques à ce monde intérieur. Autrement dit, il commence à considérer l’esprit de ses patients comme une famille intérieure, composée de diverses parts en interaction. En les écoutant sans idées préconçues, il découvre que ces parts endossent des rôles bien distincts. Certaines semblent protéger la personne. Tandis que d’autres portent le poids de blessures passées. Surtout, en explorant plus en profondeur, il identifie au cœur de chacun de ses patients une présence plus calme et confiante. Comme un noyau d’identité intact malgré les épreuves. Il nommera ce centre le Self (avec une majuscule).
De ces observations naît progressivement le modèle Internal Family Systems (IFS). Que l’on peut traduire par Système Familial Intérieur. Richard Schwartz formalise cette approche innovante à la fin des années 1980. Il commence à la présenter dans des articles et conférences. Puis en 2000, il fonde le Center for Self Leadership (devenu depuis l’IFS Institute) pour former d’autres thérapeutes à cette méthode révolutionnaire.
Les principes fondamentaux de l’IFS
Même si l’IFS est un modèle riche, ses principes de base peuvent se comprendre simplement. Richard Schwartz propose une nouvelle manière de voir notre psychisme, à la fois accessible et profonde, articulée autour de quelques notions clés.

La multiplicité du psychisme : une « famille intérieure » en chacun de nous
L’IFS part du constat que notre esprit n’est pas monolithique, mais composé de multiples facettes ou « parts ». Chacun fait l’expérience de cette multiplicité lorsqu’il dit par exemple : « Une partie de moi veut aller de l’avant, mais une autre a peur ». Pour Richard Schwartz, ce langage n’a rien d’anodin : il reflète une réalité universelle. Nous possédons tous des sous-personnalités internes, avec leurs besoins et leurs émotions propres.
Cette multiplicité n’est pas un signe de trouble psychique ; au contraire, elle fait partie du fonctionnement normal de l’esprit humain. Nos parts peuvent collaborer ou s’opposer. Un peu comme les membres d’une famille qui parfois s’aiment et parfois se disputent.
Le Self : un centre sage et compassionnel
Au cœur de notre vie intérieure, l’IFS a repéré la présence du Self, que l’on peut concevoir comme notre soi profond ou notre moi authentique. Le Self est cette part centrale de nous-même qui n’est pas blessée par les traumatismes. Richard Schwartz le décrit comme un état d’être intrinsèquement calme, curieux et compatissant. Quand nous sommes « en Self », nous éprouvons une sensation d’équilibre, de clarté et de bienveillance envers nous-même et envers autrui.
L’un des objectifs de la thérapie IFS est justement d’aider les personnes à renouer avec ce Self, cette source intérieure de sagesse et de guérison, afin qu’il devienne le chef d’orchestre de leur système intérieur. Cela ne signifie pas éliminer nos autres parts, mais permettre à ce noyau serein de prendre la place de leader pour nous guider.
Parts protectrices et parts exilées : des rôles internes complémentaires
Dans le modèle IFS, les différentes parts endossent généralement l’un des deux grands rôles suivants :
Les parts protectrices (appelées Protecteurs)
Elles cherchent à protéger la personne de la douleur et du danger. Parmi elles, les Managers sont les protecteurs proactifs. C’est-à-dire qu’ils tentent de garder le contrôle en anticipant les problèmes. Par exemple, la part qui perfectionne tout pour éviter la critique, ou celle qui évite les situations anxiogènes.
Les Pompiers, eux, sont des protecteurs réactifs : ils interviennent en urgence lorsque la souffrance intérieure devient trop intense. Un pompier va par exemple pousser la personne à se distraire ou à adopter un comportement (nourriture, alcool, travail compulsif…) pour « éteindre l’incendie » émotionnel dès qu’une détresse surgit.
Les parts exilées (ou Exilés)
Ce sont les parts vulnérables, souvent de jeunes parts d’origine, qui portent les blessures psychiques, les traumas et les émotions douloureuses (peur, tristesse, honte, sentiment d’abandon, etc.). Parce que leur charge émotionnelle est lourde, la personne apprend inconsciemment à les « exiler » pour continuer à fonctionner. Les protecteurs (Managers comme Pompiers) s’efforcent justement de maintenir ces exilés à distance de la conscience, afin d’éviter que la douleur n’envahisse le quotidien.
Ces rôles internes peuvent créer des dynamiques complexes. Il arrive que deux parts protectrices se polarisent l’une contre l’autre. Par exemple, une part stricte qui veut tout contrôler vs une part rebelle qui veut tout envoyer balader. Mais Richard Schwartz a découvert que derrière leurs stratégies parfois extrêmes, chaque part a une intention positive. Les protecteurs, même s’ils peuvent nous maintenir dans des comportements néfastes, cherchent en réalité à nous épargner une souffrance. Et les exilés, bien qu’ils contiennent nos douleurs, portent souvent nos besoins d’amour et de reconnaissance.
« Aucune part n’est mauvaise » : le postulat de bienveillance de l’IFS
Un principe fondamental de l’IFS est qu’aucune part de nous n’est mauvaise ou inutile. Richard Schwartz répète souvent que « toutes les parts sont les bienvenues ». Autrement dit, même les comportements intérieurs qui nous font du tort (auto-sabotage, critique interne sévère, compulsions…) proviennent de parts protectrices qui essaient maladroitement de nous protéger ou de gérer une douleur. Plutôt que de les combattre, l’approche IFS invite à les écouter avec curiosité et empathie. En thérapie IFS, le patient apprend à dialoguer avec chacune de ses parts, à comprendre leur rôle protecteur, et à leur apporter le soulagement dont elles ont besoin.
Cette vision non-jugeante s’oppose à l’idée de devoir « éliminer » des symptômes ou de « corriger » des traits de personnalité. Au contraire, en IFS on ne cherche pas à faire taire les parts, mais à les aider à se transformer. Lorsqu’une part exilée est enfin entendue et soulagée de son traumatisme, elle cesse de hanter la personne. De même, quand une part protectrice réalise qu’elle n’a plus besoin d’être en alerte constante, elle peut se détendre et adopter un rôle moins extrême. C’est ainsi que, peu à peu, l’harmonie intérieure se rétablit, grâce au leadership bienveillant du Self.

Une approche humaniste et compatissante de la santé mentale
Derrière le modèle IFS se trouve un profond engagement humaniste : celui de voir la santé mentale avec compassion, et non plus à travers le prisme de la pathologie. C’est notamment en cela que l’approche de Richard Schwartz résonne beaucoup avec celle de Gabor Maté et de la Compassionate Inquiry®. L’un comme l’autre s’oppose à une vision classique qui tend à étiqueter les patients en termes de troubles ou de « dysfonctionnements ».
Au lieu de considérer certaines émotions ou comportements comme des symptômes à supprimer, l’IFS propose de les voir comme l’expression de parts protectrices ayant pris des rôles extrêmes. Cette approche est résolument non pathologisante : elle n’enferme pas la personne dans un diagnostic. Mais, elle cherche à comprendre le sens et l’utilité de chaque réaction psychique.
L’auto-compassion au cœur de l’écoute IFS
Richard Schwartz prône une attitude de respect et de compassion envers les personnes en souffrance. Dans l’IFS, un comportement autodestructeur n’est pas perçu comme un signe que la personne est « malade » ou « brisée ». Mais comme le signe qu’une part d’elle a désespérément essayé de l’aider à survivre à sa douleur. Ce regard change tout : il redonne de la dignité aux individus en difficulté, en leur montrant qu’il y a en eux une logique et une intelligence. Même derrière ce qui paraît irrationnel ou problématique.
Cette philosophie a fait son chemin bien au-delà du cabinet du thérapeute. Aujourd’hui, l’influence de Richard Schwartz et de l’IFS est grandissante. De nombreux psychologues et psychiatres intègrent ce modèle dans leur pratique. Et de nombreuses études ont déjà démontré son efficacité, notamment dans le traitement des traumas.
L’IFS pour survivre à un traumatisme, mais pas seulement…
Signe des temps, l’IFS trouve aussi un écho dans des domaines non thérapeutiques. Dans le milieu du leadership et du coaching. Par exemple, on utilise les concepts de Self et de parts pour aider les dirigeants à mieux se connaître et à gérer leurs émotions avant de gérer leurs équipes. Un leader capable de reconnaître ses propres parts, comme son « manager » perfectionniste ou son « pompier » stressé, pourra développer un leadership plus authentique et serein. Il sera guidé par son Self (calme et lucide) plutôt que par ses peurs.
De même, en développement personnel, l’IFS est adopté par des personnes en quête d’épanouissement qui souhaitent dialoguer avec elles-mêmes d’une manière constructive. Dans le champ des traumatismes, des experts renommés (comme le Dr Bessel van der Kolk, auteur de Le corps n’oublie rien) recommandent l’IFS pour accompagner les survivants d’abus ou de chocs post-traumatiques. Car, tous le savent désormais : l’approche centrée sur la compassion accélère la guérison des blessures profondes. En quelques décennies, ce modèle qui était initialement une intuition de clinicien est devenu un mouvement international. Et désormais, il fait évoluer la pratique de la psychothérapie vers plus d’humanité.
Principaux ouvrages de Richard C. Schwartz
Pour diffuser sa vision et outiller aussi bien les professionnels que le grand public, Richard Schwartz a publié plusieurs livres marquants. Chacun de ses ouvrages vise à rendre l’IFS compréhensible et utile à un large public, sans tomber dans le jargon académique. Je vous parle de ses deux principaux livres sur le sujet dans cet article :
Une approche qui résonne chez les personnes traumatisées et hypersensibles
L’approche de Richard Schwartz touche particulièrement le cœur de celles et ceux qui ont vécu des traumatismes ou qui se sentent hypersensibles. Pourquoi ? Parce qu’elle offre exactement ce dont beaucoup manquent : de la compassion, de la compréhension et un espoir de guérison sans jugement. Nombre de personnes ayant traversé des épreuves lourdes portent en elles des parts blessées qui les submergent de douleur ou de peur. Dans les approches classiques, elles ont parfois eu le sentiment d’être “cassées” ou désignées comme « malades ». Face à cela, la voix de Richard Schwartz se distingue par sa bienveillance radicale. Car,il leur dit en substance « Vous n’êtes pas brisé – vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour aller mieux ».
Pour une personne en reconstruction psychique, découvrir l’IFS peut être une révélation émouvante. Plutôt que de se percevoir comme un ensemble de symptômes à corriger, elle apprend à se voir comme un système intérieur cohérent, où chaque émotion extrême, chaque réaction défensive, a son histoire et son but. Par exemple, une victime de traumatisme comprendra que ses accès de colère ou ses engourdissements face au stress sont l’œuvre de parts pompiers qui ont cherché à la protéger d’une douleur intolérable. Et non la preuve d’un caractère « mauvais » ou incontrôlable. Cette simple relecture de soi, sous l’angle de la protection plutôt que de la folie, peut apporter un immense soulagement émotionnel. Beaucoup témoignent d’un sentiment nouveau de dignité : « je ne suis pas fou/folle d’avoir ces réactions, je suis humain(e) et mon système a fait de son mieux ».
Naviguer calmement dans l’hypersensibilité avec l’IFS
Les personnes hypersensibles, de leur côté, trouvent dans l’IFS une véritable boussole pour naviguer dans leur riche monde intérieur. Être hypersensible, c’est souvent ressentir tout intensément et se faire submerger par ses émotions. L’IFS offre à ces personnes un cadre pour organiser ce foisonnement intérieur. En identifiant leurs différentes parts, elles peuvent mieux gérer leurs émotions au lieu de s’en sentir victimes. Surtout, la notion de Self, ce centre calme et plein d’empathie en chacun, les aide à ne plus considérer leur sensibilité comme une faiblesse.
Au contraire, en IFS on découvre que derrière une « part anxieuse » ou une « part trop émotive », il y a souvent un talent pour l’empathie, pour la créativité ou pour la vigilance. En apprenant à accueillir ces parts avec gentillesse plutôt qu’à les blâmer, les personnes hypersensibles développent une confiance intérieure qu’elles n’avaient jamais osé imaginer possible.
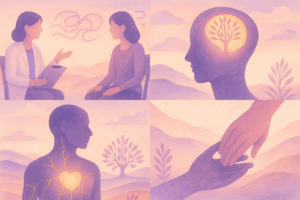
Ma rencontre avec Richard Schwartz et l’IFS
Enfin, ce qui rend l’approche de Richard Schwartz si attachante, c’est son humanité. Bien qu’il soit docteur en psychologie, son style est tout sauf froid ou clinique. Que ce soit dans ses livres, ses conférences ou ses thérapies, il communique avec chaleur, humilité et humour. Lors de ma première formation avec lui, je me souviens qu’il n’hésitait pas à partager des anecdotes ou ses propres doutes. Cette authenticité crée un lien de confiance avec le lecteur, l’élève ou le patient, qui se sent compris plutôt que jugé. Pour une personne fragile ou traumatisée, c’est un facteur de guérison en soi : on se sent enfin accueilli tel que l’on est.
En conclusion, Richard C. Schwartz, avec le modèle IFS, a insufflé un vent d’air frais dans le domaine de la psychologie. Son parcours l’a mené à écouter l’intérieur de l’être humain là où d’autres se concentraient seulement sur les symptômes visibles. Il a su montrer que derrière nos conflits intérieurs réside un potentiel d’harmonie dès lors qu’on les aborde avec compassion. Son approche, à la fois novatrice et profondément empathique, continue d’inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Et ce, qu’ils soient thérapeutes, patients en quête de guérison, ou simplement des individus désireux de vivre en paix avec eux-mêmes.
L’IFS, en rappelant qu’il n’y a pas de « mauvaises parts » en nous, redonne espoir à ceux qui ne se reconnaissaient pas dans les approches classiques. C’est peut-être là le plus bel héritage de Richard Schwartz : nous apprendre à nous regarder avec les yeux du cœur, et à trouver en nous notre propre chemin de guérison.


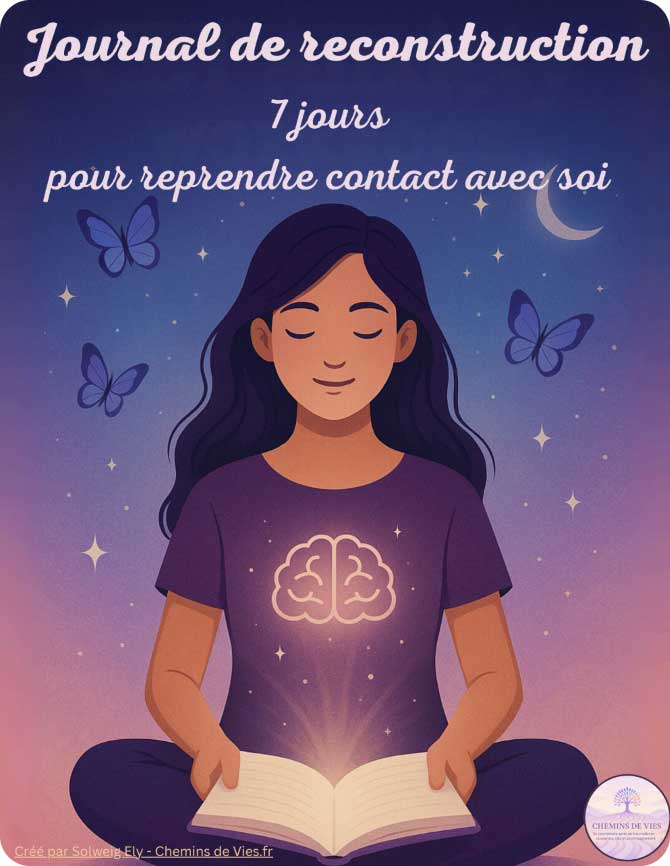
Un bel article qui explique de façon claire ce qu’est L’IFS . Je suis curieux d’en savoir plus sur la façon de procéder .