Un événement traumatique peut laisser des blessures invisibles qui perdurent bien au-delà de l’instant où il s’est produit. Lorsqu’un traumatisme n’est pas résolu, c’est-à-dire pas pleinement intégré ou traité, il continue de vivre en filigrane à l’intérieur de la personne concernée. Contrairement à l’idée reçue qu’il suffirait de “tourner la page”, le temps à lui seul ne guérit pas ce type de blessure. Et, un trauma non traité ne disparaît pas avec les années qui passent. Ses effets peuvent persister tout au long de la vie sans prise en charge appropriée. Autrement dit, l’absence d’intervention laisse souvent la souffrance s’installer et se manifester de multiples façons.
Dans cet article, nous allons explorer les conséquences psychologiques d’un traumatisme non résolu. L’objectif est de comprendre comment un tel trauma peut affecter la santé mentale, avec quelles manifestations, et pourquoi il est essentiel de s’en occuper. Nous aborderons également les pistes et approches de guérison possibles, le tout avec un ton serein et bienveillant pour rester dans l’esprit du blog Chemins de Vies.

Qu’est-ce qu’un traumatisme “non résolu” ?
On parle de traumatisme non résolu lorsqu’une expérience extrêmement pénible a dépassé la capacité de la personne à y faire face et à la digérer psychiquement. En temps normal, après un événement difficile, nous pouvons intégrer ce souvenir dans le cours de notre histoire personnelle. Si bien qu’il perd en intensité émotionnelle au fil du temps.
Dans le cas d’un trauma non résorbé, c’est l’inverse qui se produit : le souvenir reste bloqué. Il est comme rangé au mauvais endroit dans notre mémoire. La psychologue Laetitia Bluteau explique que l’individu demeure alors « encombré, parfois en permanence, par [ce souvenir] bruyant, douloureux et effrayant… comme si la menace était toujours présente, même des années après ». En somme, la personne continue à ressentir intérieurement un état d’alerte, comme si le danger n’était pas écarté. Et ce, quand bien même le traumatisme appartient au passé.
Un simple mécanisme de défense face au trauma
Souvent, ce phénomène s’explique par le fait que la victime, démunie face à la douleur de ce qu’elle a vécu, tente de refouler ou d’enterrer le trauma au lieu de le traiter. Ce mécanisme d’autodéfense, conscient ou non, s’apparente à enfermer l’événement dans une « boîte noire » intérieure pour ne plus y penser. Malheureusement, enfouir le traumatisme ne le fait pas disparaître : comme le souligne la Dr Judith Zackson, ce trauma mis de côté « ne s’en va pas. Il demeure et continue de grandir, jusqu’à ce qu’il refasse surface de manière inattendue et disproportionnée ». Autrement dit, tant que le traumatisme n’est pas réellement traité, il continue d’influencer la personne. Et, souvent à son insu, il finit par se manifester sous forme de symptômes variés.

Trauma non résolu et conséquences sur la santé mentale
Un traumatisme psychique non résolu peut avoir des répercussions importantes et diversifiées sur la santé mentale. Il affecte à la fois les émotions, les pensées, le comportement et même le corps de la personne. En l’absence de soin et d’accompagnement, les réactions de stress aigu apparues lors du choc initial peuvent persister. Elles peuvent même se chroniciser, donnant lieu à des troubles psychologiques profonds tels que le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), des troubles anxieux ou encore une dépression.
Les sections qui suivent décrivent les manifestations les plus courantes d’un trauma non traité :
Émotions intenses et anxiété persistante
La personne traumatisée demeure souvent en hypervigilance, sur le qui-vive en permanence. Des émotions vives comme la peur, l’angoisse ou même la colère peuvent surgir face à toute situation rappelant, de près ou de loin, l’événement traumatique. Le cerveau et le corps restent coincés en mode « alerte maximum », anticipant sans cesse un nouveau danger. Cette anxiété permanente est épuisante. Et, elle peut se traduire par une irritabilité importante ou une nervosité diffuse.
Reviviscences intrusives du traumatisme
Un trauma non résolu revient hanter la mémoire sous forme de flashbacks incontrôlables ou de cauchemars récurrents. Il n’est pas rare que la personne revive mentalement la scène traumatique, avec les mêmes émotions de terreur et de détresse. Comme si elle y était à nouveau confrontée sur le moment. Ces souvenirs intrusifs peuvent être déclenchés par un rien : un son, une odeur, une situation similaire… Mais, à chaque fois, ils provoquent une détresse intense.
Évitement et engourdissement émotionnel
Par peur de souffrir, beaucoup de survivants adoptent des stratégies d’évitement. Ils évitent les lieux, les personnes, les conversations ou toute activité pouvant rappeler le traumatisme. Cela peut conduire à s’isoler socialement ou à renoncer à des aspects importants de sa vie. Ce qui restreint progressivement le champ du quotidien. D’autres encore se coupent de leurs émotions par un mécanisme de dissociation : ils se sentent détachés de la réalité. Comme engourdis ou « anesthésiés » affectivement. Ce qui leur donne l’illusion de ne plus souffrir. Cette dissociation, sorte de mise à distance psychique, soulage sur le moment. Mais elle empêche d’intégrer le traumatisme et d’y répondre de façon adaptée.
Humeur dépressive et perte de confiance
À la suite d’un traumatisme non résolu, une profonde tristesse peut s’installer. La personne peut perdre confiance en elle-même et en autrui. Elle peut aussi se sentir impuissante ou coupable de ce qui est arrivé, et voir son estime de soi s’effondrer. Le désespoir et l’abattement qui en résultent mènent fréquemment à un état dépressif. On observe alors des symptômes de dépression : perte d’intérêt pour les activités autrefois appréciées, difficultés de concentration, fatigue persistante, troubles de l’appétit ou du sommeil, et parfois des pensées sombres (idées suicidaires ou autocritiques sévères). Ce risque dépressif est encore plus important si la personne n’a pas reçu le soutien émotionnel nécessaire après le drame initial. En absence d’aide, elle peut avoir le sentiment d’être brisée à jamais, sans espoir de retrouver un jour le bonheur.
Difficultés relationnelles et méfiance
Le traumatisme entame souvent la capacité à faire confiance aux autres. Une victime peut devenir méfiante, sur la défensive même avec ses proches bienveillants. Dans les cas de traumas survenus pendant l’enfance (maltraitance, abus, abandon…), on peut observer de véritables troubles de l’attachement. Car, l’enfant grandi avec une vision du monde où l’entourage n’est pas sécurisant. Et, à l’âge adulte, il lui est difficile de nouer des relations stables et sécures. Même un adulte ayant vécu un choc unique peut voir ses relations affectives affectées. En effet, après un traumatisme, la personne peut involontairement ériger des murs autour d’elle, éviter l’intimité. Ou au contraire, développer une dépendance affective par peur de l’abandon. Les liens familiaux, amicaux ou amoureux en souffrent.
Conduites addictives et comportements d’adaptation malsains
Pour anesthésier la douleur psychique qui ne cesse de faire surface, de nombreux survivants de trauma tombent dans des comportements addictifs. La consommation d’alcool ou de drogues est un moyen classique de tenter de noyer l’angoisse ou les souvenirs envahissants liés au traumatisme. Ces substances procurent un soulagement temporaire. Mais à long terme elles vont aggraver l’anxiété et la dépression, tout en ajoutant un problème de dépendance. Parfois, les stratégies d’adaptation prennent des formes plus socialement acceptées et donc plus difficiles à repérer. Comme une addiction au travail (workaholisme) ou au sport : la personne s’épuise dans une activité pour ne pas penser à son mal-être. En apparence, elle « tient le coup » au quotidien. Mais cet équilibre de façade peut s’écrouler comme un château de cartes. Car la source du problème demeure intacte.
Symptômes physiques et troubles du sommeil
L’esprit et le corps étant étroitement liés, un traumatisme non résolu s’exprime aussi à travers des manifestations somatiques. Le stress post-traumatique chronique entretient un niveau élevé d’hormones du stress dans l’organisme. Ce qui peut provoquer divers maux physiques. Parmi les symptômes fréquemment rapportés figurent des douleurs diffuses (maux de dos, de tête), des tensions musculaires persistantes, des troubles digestifs ou cardiovasculaires (palpitations, nausées, hypertension), etc… Les troubles du sommeil sont également très courants : difficulté à s’endormir, insomnies, cauchemars récurrents ou réveils en sursaut avec une angoisse nocturne. Ces problèmes physiologiques, parfois inexpliqués médicalement, sont en réalité le reflet du traumatisme qui continue d’affecter le système nerveux de la personne. Celle-ci peut vivre dans un état de tension permanente qui épuise son corps autant que son esprit.

En somme, un traumatisme non résolu peut perturber profondément la vie psychique. Bien souvent, la personne semble aller “bien” aux yeux de son entourage. Alors qu’intérieurement elle lutte contre des émotions et des réactions incontrôlables liées au passé. Ce décalage invisible peut accentuer son sentiment de solitude et d’incompréhension. Il est important de noter que ces conséquences ne sont pas des signes de “faiblesse” mentale, mais au contraire les marques d’un psychisme qui tente de survivre à une expérience extrême. Ce sont autant de signaux d’alarme qui indiquent que la blessure initiale a besoin d’être reconnue et soignée.
Vers la guérison : se reconstruire après le trauma
Face à ce tableau impressionnant de symptômes, il est légitime de se sentir dépassé. Mais la bonne nouvelle est qu’une guérison est possible. Le chemin de la reconstruction après un traumatisme est souvent long et complexe. Et, il n’existe pas de clé magique ou de solution universelle applicable à tout le monde. Chaque personne doit avancer à son rythme et trouver les approches qui lui conviennent le mieux. Il y a plusieurs chemins pour guérir, et chacun peut découvrir le sien.
Cela dit, de nombreuses méthodes ont fait leurs preuves pour accompagner la résilience et permettre d’aller mieux malgré le poids du passé. Voici quelques pistes d’aide et d’accompagnement pour surmonter un traumatisme non résolu :
Accompagnement thérapeutique professionnel
Consulter un psychologue ou un psychothérapeute spécialisé dans le traitement des traumatismes est souvent le point de départ le plus efficace. Différentes formes de thérapie peuvent aider à traiter en profondeur un trauma non résolu. Par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) ont montré leur efficacité pour identifier et restructurer les pensées négatives découlant de l’événement choquant. Une technique spécifique de TCC, la thérapie par exposition, consiste à se confronter graduellement aux souvenirs traumatiques dans un cadre sécurisé afin de s’y habituer et de réduire progressivement leur impact émotionnel. L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), quant à elle, est une approche reconnue qui utilise des stimulations bilatérales (mouvements oculaires guidés, sons alternés, tapotements) pour retraiter les souvenirs douloureux et désensibiliser la charge émotionnelle associée au trauma.
D’autres approches thérapeutiques récentes peuvent également s’avérer puissantes : par exemple, la méthode IFS (Internal Family Systems), centrée sur le travail avec les différentes “parts” intérieures de la personne. Elle permet de soigner les blessures psychiques en restaurant un dialogue bienveillant entre ces parts de soi. De même, des approches basées sur la compassion envers soi. Telles que l’approche Compassionate Inquiry développée par le Dr Gabor Maté. Elle encourage le survivant à explorer ses émotions refoulées dans un espace empathique et sécurisant, favorisant ainsi la libération du trauma. Enfin, un soutien médical peut compléter utilement le suivi psychologique. En effet, dans certains cas, un médecin peut prescrire un traitement médicamenteux (par ex. antidépresseurs, anxiolytiques) pour soulager temporairement des symptômes invalidants comme l’anxiété aiguë, l’insomnie ou la détresse dépressive. Ces médicaments n’effacent pas le traumatisme lui-même. Mais ils peuvent stabiliser la personne suffisamment pour qu’elle puisse engager le travail thérapeutique de fond.
Soutien social et entraide
Ne pas rester seul face à son traumatisme est crucial dans le processus de guérison. S’entourer de personnes de confiance, amis, famille, groupe de parole ou association de victimes, offre un espace pour exprimer ce que l’on ressent sans crainte de jugement. Le soutien social apporte du réconfort. Car, il permet de partager son fardeau émotionnel avec d’autres épaules. Par exemple, rejoindre un groupe de soutien où d’autres survivants de traumatismes partagent leurs expériences. Cela peut aider à rompre le sentiment d’isolement et à retrouver un sentiment de « normalité ». On réalise que l’on n’est pas « anormal » ou seul à vivre ces difficultés, ce qui peut déjà beaucoup soulager. La bienveillance de l’entourage sert de filet de sécurité : elle redonne un sentiment de sécurité intérieure petit à petit, condition nécessaire pour oser affronter ses peurs et avancer.
Techniques de pleine conscience et relaxation
Des pratiques de gestion du stress et de pleine conscience peuvent grandement aider à apprivoiser les symptômes post-traumatiques au quotidien. Par exemple, la méditation de pleine conscience (mindfulness) apprend à se recentrer sur l’instant présent, en observant ses pensées et ses sensations sans jugement. Avec un entraînement régulier, cela réduit l’anxiété et les ruminations en cassant le cycle des pensées traumatiques répétitives. Des exercices de respiration profonde et de relaxation musculaire peuvent calmer les réactions physiologiques de stress (rythme cardiaque élevé, tension…) lors des moments d’angoisse ou de flashback. Le yoga et le tai-chi, qui combinent mouvements doux, respiration et attention au corps, se révèlent bénéfiques pour détendre le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. En somme, toutes ces méthodes apprennent à l’individu à sortir progressivement du mode « survie » pour revenir dans le ici et maintenant, où il est en sécurité.
Approches corporelles et libération des émotions
Parce que le traumatisme s’inscrit aussi dans le corps, il est souvent nécessaire d’impliquer le corps dans la guérison. Des approches dites psychocorporelles ou somatiques aident à libérer physiquement le stress bloqué. Par exemple, la méthode du Somatic Experiencing développée par le Dr Peter Levine propose, à travers des exercices centrés sur les sensations corporelles, de compléter les réactions de survie restées inachevées lors du choc, comme la fuite ou la lutte. Cela permet de décharger l’énergie traumatique retenue dans le corps. D’autres trouveront un exutoire dans des activités physiques expressives. Danse thérapie, thérapie par le mouvement, arts martiaux doux, etc., permettent de reconnecter l’esprit et le corps. Ces pratiques offrent un moyen d’extérioriser les tensions et les émotions d’une façon saine. Par exemple, certaines personnes éprouvent un soulagement immense en frappant dans un punching-ball ou en criant dans un endroit sûr. Intégrer le corps dans le processus thérapeutique est un puissant levier : le système nerveux peut peu à peu se rééquilibrer et sortir de l’état de blocage dans lequel le trauma l’avait figé.
Expression créative et approches alternatives
En complément des thérapies conventionnelles, de nombreux survivants trouvent un grand bénéfice à des activités créatives ou spirituelles pour soutenir leur reconstruction. L’écriture est souvent citée comme un outil thérapeutique accessible. Tenir un journal intime, rédiger son histoire ou même écrire des poèmes aide à mettre de l’ordre dans ses pensées et à libérer ce qui pèse sur le cœur. Le fait de poser des mots sur l’indicible permet de reprendre du pouvoir sur le récit de son vécu. De même, l’art-thérapie (dessin, peinture, modelage…) offre un canal d’expression non verbal pour les émotions trop difficiles à verbaliser. La musique, le chant, le théâtre sont d’autres moyens de transformer la douleur en création et de retrouver du plaisir à travers l’expression de soi.
Par ailleurs, certaines pratiques dites alternatives peuvent apporter du bien-être en complément : la méditation guidée, la sophrologie, les soins énergétiques comme le Reiki, l’acupuncture, le massage thérapeutique, etc. Ces approches agissent sur la relaxation, l’équilibre intérieur et la reconnexion à son corps. Si leur efficacité varie d’une personne à l’autre, beaucoup témoignent qu’elles aident à réduire l’anxiété, à mieux dormir, ou simplement à se sentir plus en phase avec eux-mêmes. L’important est que chacun puisse piocher dans ces ressources celles qui résonnent le mieux avec lui. Il n’y a pas de « petite » aide : tout ce qui procure du soulagement et du réconfort, sans être nocif, mérite d’être envisagé dans un parcours de guérison global.

Garder espoir et avancer, pas à pas
Cheminer vers la guérison d’un traumatisme non résolu demande du temps, du courage et de la patience. C’est un processus fait de hauts et de bas, mais qui aboutit. Avec le soutien adéquat et les bonnes approches, il est tout à fait possible de surmonter les conséquences les plus lourdes d’un traumatisme. Il est possible de retrouver une vie plus sereine et épanouie. Je ne suis pas la seule : de nombreux survivants constatent qu’ils finissent par reprendre le contrôle de leur existence. Et même, par tirer de leur épreuve une nouvelle force intérieure.
En effet, en travaillant sur soi, on peut se découvrir une capacité de résilience insoupçonnée. Se sentir fort qu’avant, plus conscient de nos besoins. Et, parfois même, animés par l’envie d’aider autrui à notre tour. Ainsi, la souffrance d’hier peut se muer en compassion, en sagesse ou en détermination. Chaque parcours est unique. Mais tous prouvent qu’un traumatisme n’est pas une fatalité immuable.
Le chemin est parfois long, mais il en vaut la peine
Si vous ou l’un de vos proches souffrez d’un traumatisme non résolu, n’hésitez pas à demander de l’aide. Il n’y a aucune honte à avoir : le traumatisme est une blessure, pas un signe de faiblesse. Et comme pour toute blessure, des soins existent pour guérir. Ne restez pas seul·e avec votre peine. Tendre la main est la première étape pour aller mieux, et vous méritez de vous libérer de ce fardeau. Rappelez-vous qu’effectivement, oui, on peut s’en sortir : ce n’est pas juste un slogan. De très nombreuses personnes l’ont fait et continuent de le faire chaque jour.
Et surtout, gardez à l’esprit qu’il n’y a pas qu’un seul chemin pour guérir… les vôtres existent. En explorant ces différentes voies avec bienveillance envers vous-même, vous finirez par trouver ce qui vous aide à avancer. Peu à peu, les ombres du passé perdront de leur emprise, et vous pourrez vous reconstruire, à votre façon, vers une paix possible.


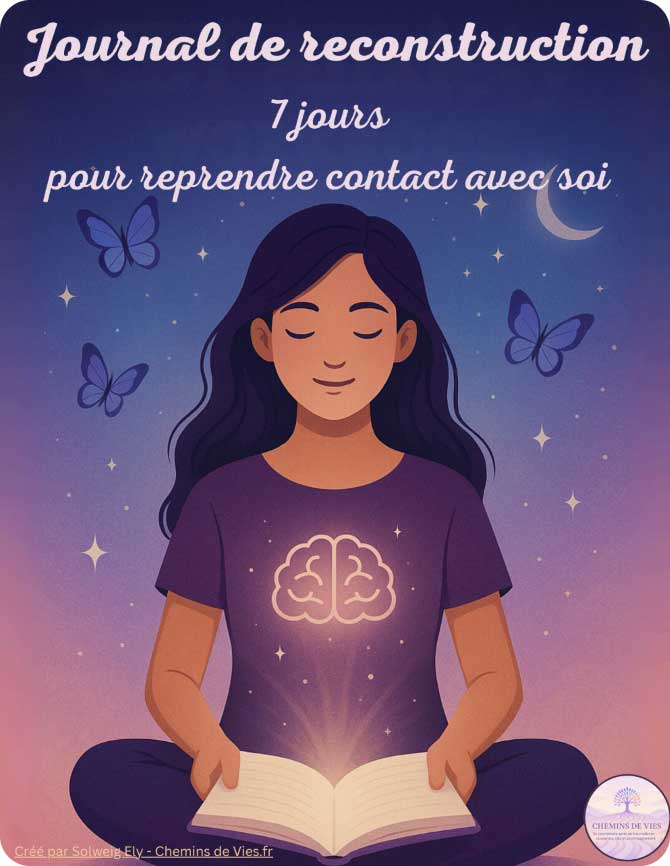
« Dans le cas d’un trauma non résorbé, c’est l’inverse qui se produit : le souvenir reste bloqué. Il est comme rangé au mauvais endroit dans notre mémoire. La psychologue Laetitia Bluteau explique que l’individu demeure alors « encombré, parfois en permanence, par [ce souvenir] bruyant, douloureux et effrayant… comme si la menace était toujours présente, même des années après ». En somme, la personne continue à ressentir intérieurement un état d’alerte, comme si le danger n’était pas écarté. Et ce, quand bien même le traumatisme appartient au passé. »
c’est exactement ça : le cerveau archaïque reste figé sur le trauma, et le passé devient le présent en permanence. Le verrouillage par la peur maintient l’état d’alerte.
Dans la grille de lecture que je propose (wetwo.fr/invisible) , cela ouvre sur deux comportements possibles :
soit on verrouille et on peut basculer du côté du bourreau,
soit on traverse, mais la souffrance reste, et on se fige dans des rôles de sauveur/victime (contrairement à ce que laisse croire la vision classique du triangle de Karpman les roles sont fixes).
Ces traumas peuvent s’exprimer sous forme de symptômes psychosomatiques si non traités …