Si vous avez vécu un choc traumatique ou des évènements profondément blessants, il est possible que vous ayez ressenti cette sensation étrange d’être « déconnecté(e)» de vous-même ou du monde qui vous entoure. On parle alors de dissociation. Ce phénomène peut être déroutant, mais il est important de savoir qu’il s’agit d’une réaction de survie bien connue en psycho-traumatologie.
Parce que, comprendre ce qui nous arrive est une étape importante sur le chemin de reconstruction, dans cet article, je vais vous partager ce qu’est la dissociation. Une expérience que j’ai bien connue, durant de longues années. Et, qu’il m’arrive encore de côtoyer brièvement de temps en temps, quand les réminiscences de mes blessures refont surface. Je vais donc vous partager ce que j’ai appris sur ses causes, ses mécanismes, ses différentes formes et ses conséquences au quotidien.
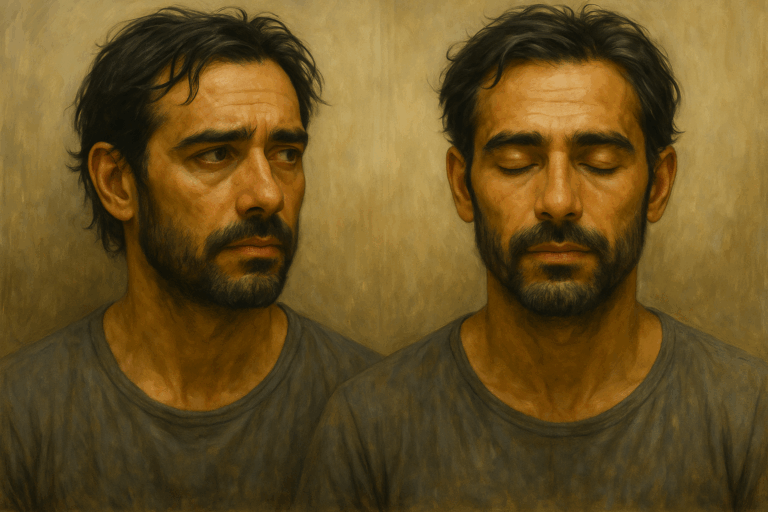
Qu’est-ce que la dissociation ?
D’un point de vue médical, la dissociation désigne une déconnexion involontaire entre certaines fonctions psychiques : conscience, mémoire, émotions, identité ou perception de l’environnement. C’est, en somme, une prise de distance automatique de l’esprit face à une réalité trop difficile à supporter. Tout le monde peut connaître des moments de légère dissociation sans gravité. Par exemple lorsqu’on rêvasse en voiture et qu’on oublie une partie du trajet. Ce type de dissociation normale (ou abstraction hypnotique) est fréquent et ne perturbe pas le cours de la vie quotidienne.
En revanche, lorsque la dissociation devient un mécanisme d’adaptation face à un stress extrême ou un traumatisme, elle peut prendre une forme beaucoup plus prononcée et problématique. La personne peut omettre des pans entiers de ce qui vient de se passer, ressentir une perte de la notion du temps, ou avoir l’impression d’être détachée de son corps et de ses émotions. Cette dissociation peut se manifester lors du trauma lui-même et se répéter par la suite. Elle correspond alors à une véritable altération de la conscience de soi et de la réalité. Il s’agit d’un processus psychologique de survie qui permet à l’esprit de la victime de se couper de l’horreur insupportable de l’événement vécu.
Un mécanisme de survie
Lorsqu’une personne est confrontée à un stress extrême ou un danger vital, par exemple pendant une agression, un accident grave ou tout autre traumatisme, le cerveau peut déclencher un mode de protection d’urgence. La dissociation traumatique est ainsi décrite comme un « mécanisme neuro-biologique de sauvegarde » mis en place par le cerveau pour survivre à l’impensable. Sous l’impact d’une peur ou d’une douleur extrême, le cerveau va « disjoncter » certaines connexions neuronales.
L’amygdale cérébrale, qui orchestre la réaction émotionnelle et la réponse de stress, est temporairement mise hors circuit par rapport aux autres régions cérébrales. Cela a pour effet d’interrompre la production d’hormones de stress (comme l’adrénaline et le cortisol) et de provoquer une anesthésie émotionnelle et sensorielle. En d’autres termes, la personne devient insensible sur le moment. Elle ne ressent plus la douleur, ni la peur, ni les émotions liées au traumatisme. C’est un état de détachement qui la protège du choc insupportable.
Dissociation et mémoire traumatique
Ce processus de sauvegarde a également un impact sur la mémoire. En isolant l’amygdale, le cerveau empêche l’hippocampe d’intégrer le souvenir de manière cohérente. Les fragments de mémoire émotionnelle et sensorielle de l’événement ne sont pas triés ni rangés dans la mémoire autobiographique normale. Ils restent « bruts », comme hors du temps.
C’est ce qu’on appelle la mémoire traumatique, laquelle peut, plus tard, ressurgir sous forme de flashbacks envahissants, de cauchemars ou de réminiscences incontrôlables. La dissociation et la mémoire traumatique sont donc intimement liées. La première permet de survivre sur le moment en se coupant de l’expérience, mais elle aboutit à des souvenirs traumatiques non traités qui pourront hanter la victime par la suite.
Un mécanisme involontaire mais protecteur
Ce mécanisme de dissociation est involontaire : la personne ne « choisit » pas de se dissocier. C’est son psychisme qui y recourt automatiquement pour la protéger. Il s’agit d’une réaction normale face à une situation anormale. Par exemple, lors d’une agression, certaines victimes décrivent avoir eu l’impression de « se voir de l’extérieur ». Ou que la scène n’était pas réelle, comme si elles étaient en train de rêver ou de regarder un film. D’autres rapportent s’être senties figées, incapables de bouger ni de crier : on parle alors de « sidération ».
Toutes ces manifestations permettent à l’esprit de mettre à distance l’horreur pour éviter un potentiel effondrement psychique ou même un risque vital (par exemple un arrêt cardiaque dû au stress massif). En ce sens, la dissociation est bien un mécanisme de survie à court terme.

Formes et symptômes de la dissociation traumatique
Après un traumatisme, la dissociation peut persister et prendre plusieurs formes. Chaque personne est unique et peut vivre la dissociation à sa manière. Mais il existe des symptômes courants de la dissociation post-traumatique, notamment :
Troubles de la mémoire
Il peut s’agir d’une amnésie partielle ou totale autour du traumatisme. Il n’est pas rare qu’une victime ne se souvienne pas clairement des événements. Ces oublis résultent du cerveau qui a évacué des informations trop pénibles
Sentiment d’irréalité
Aussi appelée « déréalisation », c’est cette impression que le monde est lointain, flou, irréel. Les lieux et les gens semblent étranges, comme dans un rêve. Ce sentiment d’évoluer dans un décor fictif s’accompagne souvent d’un engourdissement émotionnel : rien ne semble vraiment avoir de consistance ou d’importance.
Sentiment de détachement de soi
La « dépersonnalisation », c’est l’impression d’être extérieur à son propre corps ou à son esprit. La personne peut se voir agir comme si elle était spectatrice d’elle-même, se sentir flottante ou désincarnée. Elle peut avoir la sensation de ne plus reconnaître son visage dans le miroir ou que son corps n’est pas le sien. Ses émotions paraissent coupées, comme si un « mur » la séparait de ce qu’elle ressent.
Confusion de l’identité
Certaines personnes dissociées se sentent divisées intérieurement, avec des « parts » d’elles-mêmes étanches les unes aux autres. Elles peuvent agir tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Comme si différentes personnes cohabitaient en elles. Dans des cas extrêmes, mais rares, cela peut mener à un trouble dissociatif de l’identité.
Sans aller jusqu’à ce diagnostic qui ne peut être posé que par un médecin spécialiste, beaucoup de survivants de traumatismes ressentent cette fracture intérieure. Par exemple, une partie d’eux semble fonctionner en pilote automatique dans la vie quotidienne, tandis qu’une autre partie reste figée dans le passé traumatique.
Autres symptômes psychiques et physiques
La dissociation s’accompagne souvent d’une grande anxiété, de crises de panique, de flashbacks intrusifs où la personne revit le traumatisme comme si elle y était (images, sensations corporelles, terreur soudaine). On observe aussi fréquemment des cauchemars récurrents, une insomnie, et divers troubles psychosomatiques.
La personne dissociée peut paraître absente, indifférente à tout. Ou au contraire en proie à des sursauts de détresse intense quand des fragments de mémoire resurgissent. Ces oscillations entre engourdissement et détresse aiguë font partie intégrante du tableau dissociatif.
Tous ces signes sont des réponses post-traumatiques :
ce n’est ni de la folie ni de la faiblesse.
Conséquences de la dissociation au quotidien
La dissociation protège à court terme mais, lorsqu’elle persiste, elle peut perturber profondément la vie quotidienne. Parmi les conséquences les plus fréquentes :
Engourdissement émotionnel et relations altérées
La personne se sent vide affectivement, détachée de ses proches, comme anesthésiée dans ses relations. Elle peut éprouver du mal à ressentir de la joie, de l’amour ou même de la tristesse. Cette froideur involontaire peut être incomprise par l’entourage et engendrer un sentiment d’isolement.
Altération de l’estime de soi et de l’identité
Vivre avec des pertes de mémoire, des changements d’humeur inexpliqués ou le sentiment d’être différent des autres peut profondément ébranler la confiance en soi. Les survivants dissociés rapportent souvent un sentiment d’étrangeté par rapport à eux-mêmes, de ne pas se reconnaître. Ils peuvent se croire « fous » ou brisés, surtout si leur état n’est pas compris par les professionnels autour d’eux.
Par exemple, une victime qui ne ressent « rien » après un viol peut se culpabiliser de ne pas réagir « normalement », alors qu’il s’agit d’un effet courant de la dissociation. Sans explication, cette étrangeté nourrit une faible estime de soi et parfois un dégoût de soi.
Difficultés de concentration et fonctionnement au quotidien
Les troubles de mémoire et les absences mentales liés à la dissociation compliquent souvent la vie scolaire ou professionnelle. Il peut être ardu de se concentrer, d’apprendre de nouvelles informations, de garder une continuité dans les tâches. Des personnes dissociées décrivent des journées floues, une notion du temps perturbée, ce qui rend la gestion du quotidien chaotique.
La dissociation chronique peut ressembler à être en « pilotage automatique » en permanence, avec un sentiment d’irréalité qui rend difficile la prise de décisions ou la projection dans l’avenir. Cela s’accompagne souvent de fatigue mentale intense.
Comportements à risque et re-victimisation
Paradoxalement, le fait de ne plus ressentir ni la peur ni la douleur de façon normale peut exposer la victime à de nouveaux dangers. Insensible aux signaux d’alarme, puisque tout semble lointain, la personne dissociée peut tolérer des situations abusives ou dangereuses beaucoup plus qu’elle ne le devrait. Elle risque de rester sous l’emprise d’un agresseur sans parvenir à se défendre, ou de tomber sous la coupe d’autres personnes malveillantes. Car son état de sidération l’empêche de réagir et de se protéger.
De plus, pour échapper aux effrois de la mémoire traumatique qui surgissent parfois, certaines victimes développent des stratégies d’évitement malsaines. Comme l’abus d’alcool ou de drogues pour engourdir les sensations. Ou, des conduites autodestructrices (automutilations, conduite dangereuse, prises de risque inconsidérées) dans le but de retrouver un état dissocié et anesthésié au lieu de subir les flashbacks. Ces comportements apportent un soulagement temporaire mais ils aggravent les problèmes sur le long terme (mise en danger, addiction, etc.). La dissociation chronique peut donc entraîner un cercle vicieux destructeur.
Impact sur la santé physique
Le stress extrême et l’engourdissement prolongé peuvent également avoir des conséquences sur le corps. La « déconnexion » signifie que la personne ne prête plus attention aux signaux de son corps. Elle peut négliger sa santé, ne pas sentir des douleurs pourtant alarmantes, repoussant les limites de son organisme.
À long terme, cela peut contribuer à des problèmes médicaux non pris en charge. Et, le stress psychique non exprimé peut favoriser des troubles psychosomatiques (douleurs chroniques, troubles digestifs, troubles du sommeil, etc.). La dissociation traumatique a ainsi un impact global sur la santé psychique et physique.

Comprendre et reconnaître la dissociation pour mieux accompagner
En somme, la dissociation prolongée empiète sur la vie de la personne de multiples façons. Elle la protège de la souffrance aiguë, mais au prix d’une diminution de sa qualité de vie. D’autant que cette réaction de survie est souvent mal comprise de l’entourage et même de certains soignants : une victime dissociée peut paraître calme ou détachée, et ne pas susciter l’empathie spontanée de ceux qui ignorent ce mécanisme.
Il arrive que des professionnels non formés confondent la dissociation avec d’autres troubles (par ex. autisme, schizophrénie, troubles de la personnalité. Ce qui peut conduire à des erreurs de diagnostic et à un manque de prise en charge adéquate. Il est donc crucial de sensibiliser à la dissociation traumatique pour que les victimes soient crues, comprises et aidées correctement.
La dissociation n’est ni de la simulation ni de l’exagération, mais bien le signe d’un psycho-traumatisme qui nécessite une approche spécifique et empathique. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, n’oubliez pas que le chemin vers la reconstruction nécessite patience et bienveillance. Mais surtout, sachez qu’il est possible de surmonter la dissociation !
Je vous donne quelques ressources qui peuvent vous accompagner en ce sens :
Vous voulez faire un premier pas pour vous reconnecter à vous-même ?
Recevez gratuitement :


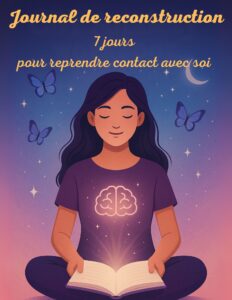
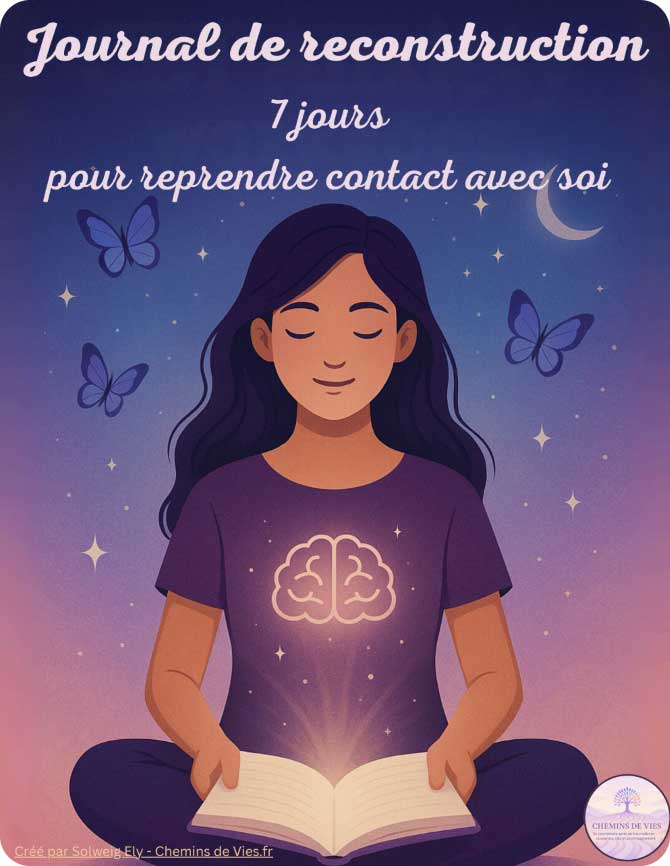
Je te remercie pour cet article très clair sur ce trouble. Etant professionnel de santé j’ai eu une formation sur les violences faites aux femmes et on nous avait expliqué ce trouble en insistant sur le fait que c’est un mécanisme du cerveau et pas une attitude de la personne.Merci
Merci pour ton partage ! En effet, il me paraît essentiel de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une attitude ou d’un travers, mais bien d’un mécanisme de survie tout à fait normal et naturel. Un message à faire passer au plus grand nombre…