Très souvent, quand j’accompagne des personnes, je m’entends dire : « C’est vrai que moi, je n’ai pas vécu une histoire aussi horrible que toi, mais… » Mais quoi ? Existe-t-il une hiérarchisation de la souffrance psychologique ? Dans ce cas, est-ce que j’avais vraiment le droit de souffrir des abus sexuels que j’ai subis étant enfant ? Mes traumatismes n’étaient-t-ils pas ridicules, alors même que d’autres ont vécu des violences bien plus extrêmes ? Cela voudrait dire qu’un traumatisme psychologique doit être évalué en fonction du summum de l’horreur…
Je ne crois pas… Car, s’il y a bien une chose dont je suis convaincue, c’est qu’un même événement vécu par deux personnes différentes, sera appréhendé de manière profondément différente de la part de chacune d’elle. Et, ce qui peut être, un jour, un mauvais souvenir pour l’un, peut-être, à vie, profondément traumatisant pour l’autre.

Dédramatiser le mot « traumatisme » et repérer ce qui est “caché” en soi
Lorsque j’ai commencé à travailler avec l’Internal Family System (IFS), j’ai découvert que certaines de mes douleurs, que je n’avais jamais nommées “traumatisme”, portaient pourtant toutes les marques d’une blessure profonde. Il ne s’agissait pas de l’inceste, cette horreur à laquelle mon livre Le Silence et la Honte fait référence. Non, il s’agissait des paroles blessantes, des mots non-dits, des attentes non comblées, des humiliations banalisées, des rejets voilés que j’avais sous-estimés. Ces « petites » blessures avaient creusé des sillons en moi. Les reconnaître m’a permis de comprendre qu’il n’y a pas de hiérarchie dans la souffrance : chaque blessure est digne d’être entendue et soignée.
C’est à partir de ce vécu que je souhaite vous montrer une perspective moins intimidante du mot “traumatisme”. Certes, il peut renvoyer à des drames extrêmes, mais aussi à ces blessures moins reconnues, qui méritent, elles aussi, attention et guérison. Car un traumatisme n’est pas seulement une violence spectaculaire, ce sont aussi ces blessures relationnelles, quotidiennes, subtiles, qui façonnent nos replis et nos fragilités.
Pourquoi le mot “traumatisme” paraît si lourd
Le mot “traumatisme” porte avec lui une dimension presque mythique, car, on l’associe aux guerres, aux agressions, aux catastrophes. Et il est vrai que ces événements demandent une reconnaissance autant qu’un long travail de guérison. Mais cette connotation lointaine et dramatique donne souvent le sentiment que “je ne suis pas assez blessé(e) pour parler de ça”.
Or, des travaux sur la maltraitance psychologique, les abus émotionnels chroniques ou la négligence relationnelle montrent que les effets sur l’esprit peuvent être tout aussi puissants. Par exemple, une étude appelée Death by a Thousand Cuts (Traumatismes invisibles) explique que la maltraitance psychologique continue souvent d’agir dans le temps. Avec des conséquences sur la santé mentale équivalentes, voire supérieures, à celles des abus physiques.
Donc, le défi consiste à élargir notre regard : le traumatisme n’est pas seulement ce qui “dérape violemment”, mais aussi ce qui use, ronge ou inhibe, au fil des jours.
Les blessures silencieuses qui s’apparentent à un traumatisme
Le trauma, dans un sens plus large et humain, se décrit comme un dépassement de seuil, un moment où ce qui survient éclipse la capacité intérieure à l’intégrer. Certaines souffrances laissent des traces profondes sans bruit ni éclat. Dire qu’une blessure est “traumatique” ne nécessite pas qu’elle ait été spectaculaire.
Voici quelques-unes des blessures fondamentales que Lise Bourbeau explore dans Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même.
Elles agissent souvent en silence, mais façonnent profondément notre façon d’aimer, de réagir, de nous relier aux autres, et à nous-mêmes.
La blessure du rejet : le sentiment de ne pas avoir de place
Le rejet, c’est l’expérience intime de ne pas “être voulu”.
Il peut naître d’un regard fuyant, d’un parent émotionnellement absent, d’une phrase anodine qui dit pourtant : tu n’étais pas attendu comme tu es. Celui ou celle qui porte cette blessure apprend très tôt à se faire discret, à passer sous le radar pour ne plus déranger.
Derrière cette retenue se cache souvent une question douloureuse : ai-je vraiment le droit d’exister ? Ainsi, le rejet conduit à l’invisibilité intérieure, à cette impression d’être à côté du monde, comme si la vie continuait sans soi.
La blessure de l’abandon : quand le cœur s’éloigne
Elle naît dans le manque d’attention, de présence ou de chaleur. Quand nos émotions n’ont pas trouvé d’oreilles pour les accueillir, un vide s’installe. On finit par croire que nos besoins dérangent, que notre peine est trop lourde pour être portée par quelqu’un d’autre.
L’adulte blessé par l’abandon oscille entre la dépendance affective, tout faire pour ne plus être seul, et la fermeture du cœur, pour ne plus jamais risquer d’être quitté. C’est une blessure du lien. Elle apprend à se protéger même de l’amour qu’on désire.
L’humiliation : la honte qui se tait
Elle s’insinue dans les comparaisons, les critiques déguisées, les plaisanteries piquantes. L’humiliation murmure : tu n’es pas à la hauteur. Celui qui la porte vit souvent dans l’autocensure, la peur du ridicule, le besoin constant d’être irréprochable pour ne plus être exposé.
Souvent, il se sacrifie pour plaire ou se fond dans le décor pour éviter le regard jugeant. Derrière la docilité, il y a une profonde honte de soi, apprise très jeune, qui réclame aujourd’hui d’être reconnue — et apaisée.
La trahison : la confiance fissurée
Elle apparaît quand une promesse s’effondre. Par exemple, quand celui ou celle en qui l’on croyait s’éloigne sans un mot. La trahison brise la foi dans le lien. Et, avec elle, naît le besoin de tout contrôler pour ne plus jamais être pris au dépourvu.
Celui qui la porte veut garder la main sur tout : les situations, les gens, parfois même sur ses propres émotions. La méfiance devient réflexe, l’hypervigilance une armure. Et derrière cette dureté, il y a une peur viscérale : celle de faire à nouveau confiance… et de le regretter.
L’injustice : le manque de reconnaissance
Elle prend racine dans les comparaisons, les jugements constants, les attentes impossibles. Quand rien n’est jamais assez bien, l’enfant apprend à se durcir pour ne plus sentir l’humiliation du “pas assez”.
Devenu adulte, il porte souvent le masque du perfectionniste rigide : exigeant, fier, rarement satisfait. Il s’interdit la vulnérabilité, confondant sensibilité et faiblesse. L’injustice intériorisée devient alors une lutte perpétuelle contre soi-même, où l’on tente de mériter une reconnaissance qui ne vient jamais.
Pourquoi ces blessures sont “traumatiques”
Ces blessures silencieuses peuvent agir comme des traumas parce qu’elles :
- Fragmentent la confiance en soi et en l’autre ;
- Activent des parts intérieures blessées, qui restent en état d’alerte ;
- Inhibent la vérité personnelle : certaines parts restent muettes pour survivre.
- Motivent des stratégies d’adaptation (retrait, contrôle, dépendance…) qui isolent ;
- S’incarnent dans le corps : tensions, douleurs, épuisement ;
En ce sens, les approches plus larges du traumatisme (IFS, Compassionate Inquiry, psychologie relationnelle) reconnaissent que ce qui reste muet crie dans le corps.
Un traumatisé "normal" : les manifestations discrètes des blessures
Quand on porte une blessure intérieure, pour ne pas dire psychique ou traumatique, le corps et l’esprit “dialoguent” à travers des symptômes souvent invisibles :
- Réactions émotionnelles disproportionnées : colère, tristesse, anxiété qui surgissent avec de “petits” déclencheurs
- Zones sensibles : certains mots, regards ou situations déclenchent une douleur intérieure bien plus forte que ce qu’on attendrait
- Difficultés relationnelles profondes : peur de la confiance, retrait progressif, isolement, soupçon
- Évitement intérieur ou dissociation : “je me coupe de moi-même”, je deviens neutre pour ne plus souffrir
- Fatigue chronique, douleurs inexpliquées, tensions corporelles : le corps “porte” souvent ce que l’esprit ne peut pas exprimer.
- Intuition d’un “quelque chose en moi qui freine” : le sentiment d’être “bloqué”, de ne pas avancer, de buter sur soi-même.
Ces manifestations peuvent être acceptées comme “mon caractère”, “ma sensibilité”, “mes défauts”. Voilà pourquoi tant de personnes ne font jamais le lien avec une blessure psychique profonde.
Quand, moi aussi, je me vois comme une "banale traumatisée"
Pendant longtemps, j’ai pensé que seules les violences extrêmes justifiaient qu’on parle de traumatisme. Mais, lors de mes premières séances de thérapie IFS, j’ai rencontré des parts de moi blessées par des choses que je croyais « anecdotiques ». Par exemple, lorsque mes parents m’ont imposé le silence et le point de leur autorité, jusqu’à l’aube de mes 30 ans. Je ressentais un écrasement identique à celui de mon enfance. On m’avait aussi souvent répété que si j’avais souffert, c’était parce que je l’avais « mérité ». Induisant, encore et toujours, le poids de la culpabilité et le rôle de la « pécheresse ».
Ces paroles, ces silences et ces attitudes m’ont marquée autant que les violences physiques que j’ai subies. Elles ont façonné ma relation à moi-même, aux autres, au monde. Comprendre cela m’a permis de reconnaître ces blessures comme réelles et légitimes. C’est ainsi que la notion de trauma s’est élargie dans ma conscience
Les traumatismes psychologiques englobent aussi les blessures de dignité, d’appartenance, de confiance, d’écoute.
Un mot élargi, un espace libéré
Dédramatiser le terme “traumatisme”, ce n’est pas le banaliser : c’est le rendre accessible. Le rendre audible dans ce qui se vit à l’intérieur. En élargissant ce mot, chacun peut reconnaître ses blessures (même les plus subtiles) et leur offrir de nouvelles chances de guérison.
Vous n’avez pas à prouver un niveau de souffrance pour être légitime. Si vous avez porté des rejets, des humiliations, des silences, des trahisons ou des attentes écrasantes, ces fragments méritent aussi d’être entendus. En les nommant, en leur donnant du regard, en les accompagnant, avec douceur, ils peuvent enfin circuler, se détendre et se pacifier.
Vous voulez faire un premier pas vers vos blessures intérieures ?
Recevez gratuitement votre journal de reconstruction :
« 7 jours pour me reconnecter à moi-même »


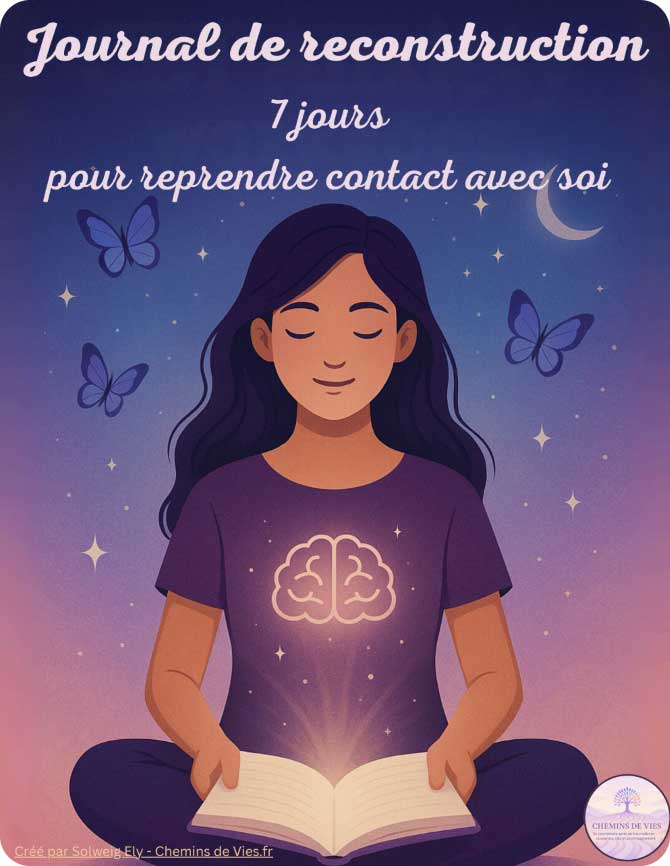
Merci Solveig, d’ouvrir les portes invisibles. Après s’être longtemps dit : « Je ne suis pas assez blessé(e) pour parler de ça », on entend maintenant les autres dire « On a déjà tout dit sur les traumas, on peut parler d’autre chose ? »
Ton article nous rappelle que chaque chemin est unique, et chaque voix mérite d’être entendue, par elle-même avant tout.
ah mais je te rassure, ca devient banal aujourd’hui d’avoir subi des violences d’un pédophile de l’Eglise…
Passons cette plaisanterie qui malheureusement n’en est pas vraiment une ( L’eglise a créé des tas de traumas et pas que sexuels – au fil de l’ Histoire et DES histoires personnelles) , je découvre ton site ce jour et je le trouve vraiment touchant.
le lire a reveillé des émotions et écrire ces quelques lignes en reveille d’autres ! Je pourrais écrire des 10aines de pages !
Je suis bien d’accord sur le fait que le même évènement ne procure pas du tout le même effet chez des personnes différentes. S’exprimer permet de se libérer et ne pas laisser s’installer le trauma mais il faudrait pouvoir le faire avant 21 jours..une question de programmation encore …
Belle continuation à toi, belle âme
Merci Solweig. Ton article fait l’effet d’un électrochoc…merci de « mettre des mots » sur ces blessures et traumatismes, c’est un vrai réconfort. Car en étant seul face à ses blessures…il est difficile de choisir soi-même les « bons mots ». Et nommer ses blessures en utilisant « les mots justes », c’est un bon début pour accepter ses blessures et poursuivre son chemin. Je continue à te lire avec un immense plaisir.